To toot the Nextcloud horn and suggest a provider, I switched from GDrive to Nextcloud hosted on a Hetzner Storage Share a few months ago and it’s been smooth and fun, for 5-6€/month for 1TB (not sure how it compares, but it feels a acceptable, as GDrive was costing me 3€). Now I also have my calendar, tasks, and I’m currently migrating my bookmark managing from Raindrop. I used to share GPhoto albums with family and I’m trying this next with the Memories app.
However, it seems like there’s no solution to easily backup Whatsapp content without GDrive, but as long as there’s less than 15GB of stiff I can at least stay on Google’s free plan.








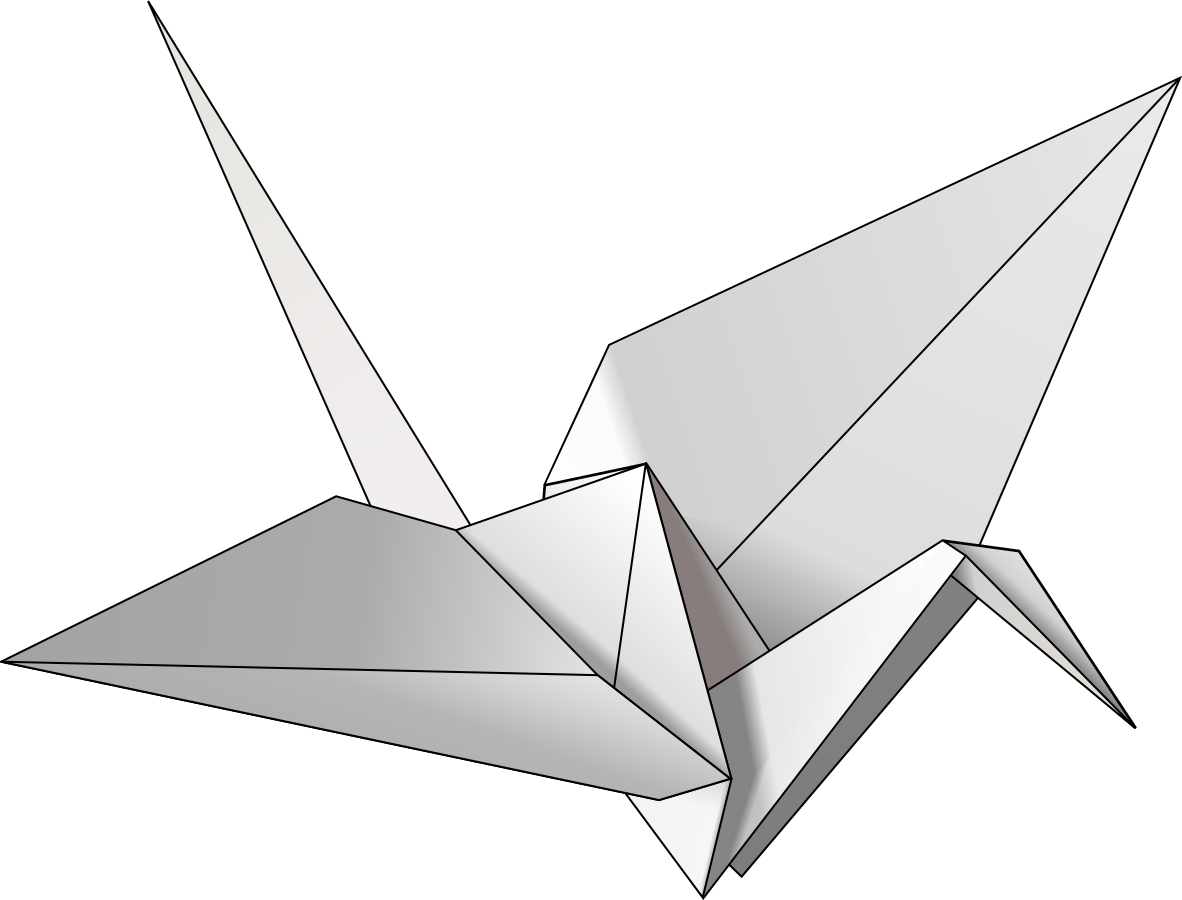

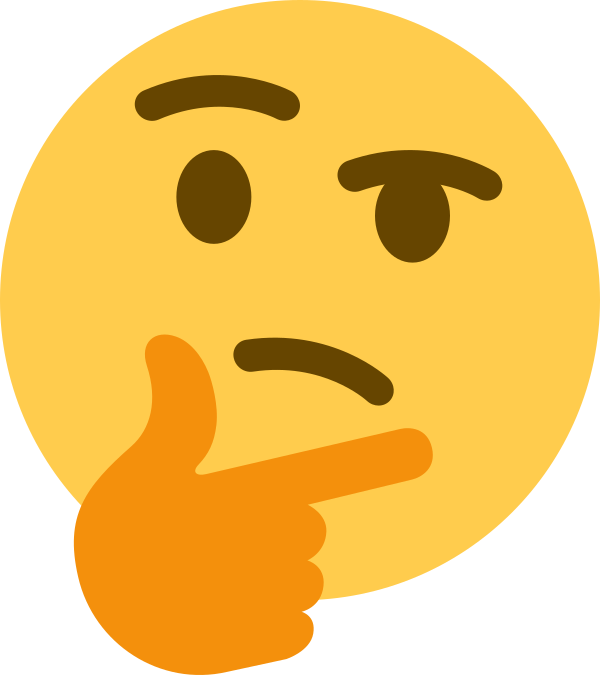

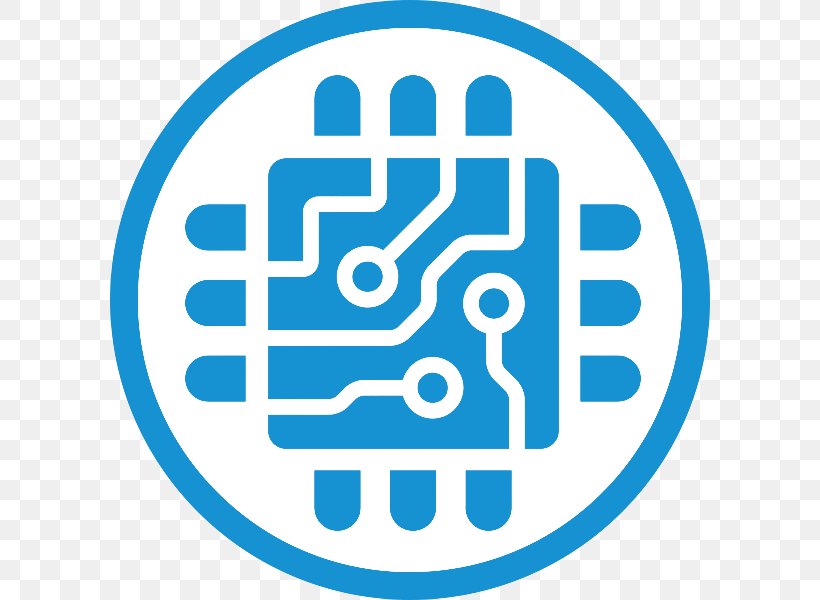
They give the example of Tailwind CSS, who sell UI blocks/kits and templates. I think that sounds like more added value than just pay me to help you use my software.
Even for projects that don’t advertise commercial products, I can believe that not needing to leave the chat/IDE to do anything leads to less traffic on GitHub etc, which is where the donate buttons are for ex.